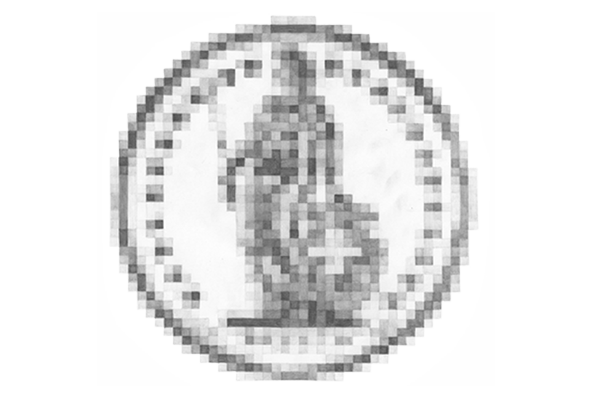Luzius Meisser a fondé, durant ses études, une jeune pousse avec le service de stockage Wuala.
Oui, nous avons fréquenté à l’époque tous les modules « venturelab » de l’Institut für Jungunternehmen (IFJ). La graine était, cependant, déjà en terre. Nous avions dès le début l’intention de créer notre propre entreprise. De telles offres sont toutefois très utiles, dans le sens où elles facilitent les échanges avec des gens qui partagent les mêmes objectifs. Ces contacts m’ont même plus appris que le contenu des cours à proprement parler.
Il est instructif de voir comment les autres sociétés se présentent, quelles sont leurs idées et comment elles sont conçues. On a le sentiment de pouvoir s’évaluer les uns les autres et mieux apprécier la pertinence de sa propre vision.
Tout à fait. Ce caractère de plateforme est important. Ce sont des points de rendez-vous où les créateurs peuvent travailler et avoir des échanges notamment sur les technologies. Le Colab, à Zurich, en est un exemple. Il offre un espace de travail ouvert, où les nomades numériques peuvent boire un café et brancher leur ordinateur portable. On voit aussi émerger d’autres services, comme les bureaux « pop up » qui permettent de trouver et de réserver des postes de travail sur mesure et même, au besoin, des salles de conférences.
Oui ! Il y en a même presque trop. La participation à des concours implique de consacrer chaque fois plusieurs heures au dossier et à la présentation. Dans la plupart des cas, on n’est d’ailleurs pas retenu. En fin de compte, les candidats perdent ainsi un temps énorme qu’ils auraient mieux fait d’investir dans le produit lui-même.
Ces concours sont financés par des capitaux privés.
Oui, le financement vient souvent de fondations. Il y a déjà presque une surabondance d’événements dédiés aux jeunes pousses. C’est devenu un thème à la mode. Une « start-up » doit se montrer sélective.
Dans la mesure du possible, l’État ne doit pas se mettre en travers de leur chemin. Sa responsabilité consiste à établir des conditions-cadres. On doit pouvoir facilement créer une entreprise et recruter du personnel. C’est pour cela qu’il est également important de pouvoir parler d’égal à égal avec les autorités. En Suisse, cela fonctionne bien grâce au fédéralisme. Un entrepreneur qui veut engager un ressortissant de l’UE, par exemple, peut sans problème appeler l’office local du travail et obtenir des informations solides.
Malheureusement, ce n’est plus aussi facile qu’avant. Récemment, j’ai entendu parler de jeunes pousses qui peinent à trouver une banque pour ouvrir un compte de consignation – c’est le cas par exemple quand des investisseurs américains participent au capital. Or, la loi prévoit que l’on ne peut pas fonder une entreprise sans posséder un tel compte auprès d’une banque suisse. L’un de mes amis gère une jeune pousse, dûment autorisée par la Finma, qui fait des transactions en bitcoins. Cet entrepreneur n’a pas réussi à ouvrir un compte en Suisse, bien qu’il ait rempli les formulaires nécessaires dans plus de cinquante établissements. Finalement, il s’est replié sur une banque du Liechtenstein. Cette situation est problématique, car la place financière suisse a besoin de « start-up » et d’innovation.
Effectivement. Il existe, toutefois, un nombre grandissant de petits obstacles.
Les projets d’innovation peuvent être financés par le biais de la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) et du Fonds national suisse. J’estime correct que l’État ne les subventionne pas directement.
Prenons l’exemple de Myke Näf, l’un des fondateurs de Doodle. Comme tous les créateurs d’entreprises que je connais, cet homme investit l’argent qu’il a gagné avec cette société dans de nouvelles jeunes pousses auxquelles il croit personnellement. Si les choses tournent mal, il perd ses propres capitaux. Il a donc tout intérêt à surveiller de près sa société. Imaginons maintenant un système de subventions directes : l’État prive Myke de cet argent pour le placer, après mille détours, dans un fonds d’encouragement ; il en confie l’affectation à un fonctionnaire qui ne risque pas sa peau dans l’aventure. C’est une aberration. Non seulement des fonds vont se perdre en route, mais on verra de l’argent « intelligent » se transformer en argent « stupide ».
Il existe divers types d’investisseurs. D’un côté, il y a ceux qui ont de l’argent, mais qui ne connaissent pas grand-chose aux affaires – c’est le cas des caisses de pension. Au-delà du financement, ils ne peuvent guère contribuer au succès de l’investissement. C’est que l’on appelle l’argent stupide. En revanche, l’argent intelligent vient d’investisseurs qui apportent également un réseau et une grande expérience, qui sont capables de conseiller et d’aider activement l’entreprise. Pour les jeunes pousses, il est essentiel d’obtenir des capitaux « intelligents ». Cela fait une énorme différence.
Oui, cette phase est un peu plus difficile en Suisse. Néanmoins, elle reste plus facile que dans le reste de l’Europe. On trouve, en effet, de l’argent dans ce pays, de même que des gens capables d’assumer une importante opération de financement. En revanche, il n’existe pas en Suisse de valorisations excessives, comme celle de la société Uber, dont on prétend qu’elle vaut autant que l’ensemble du Credit Suisse.
Cela tient à l’auto-amplification de l’argent intelligent. Aux États-Unis, ce processus est déjà ancien. Chaque cycle de jeunes pousses qui réussissent amène plus d’argent et plus de fondateurs. Le capital-risque s’est donc multiplié dans ce pays. Il y a toujours plus d’argent à disposition, alors que le nombre de « start-up » est limité, car le nombre des gens qui y travaillent l’est aussi. Avec le succès croissant de ces entreprises, les évaluations sont donc toujours plus hasardeuses.
D’après mon expérience, toute entreprise compétente peut obtenir de l’argent en présentant un bon plan. Je pense que le problème se situe ailleurs, à savoir dans les conditions géographiques. Depuis la Suisse, on doit surmonter des barrières linguistiques et culturelles si l’on veut atteindre 300 millions de clients. Ce qui fonctionne dans notre pays ne fonctionnera pas nécessairement en Allemagne ou en France. Aux États-Unis, en revanche, on se trouve dès le départ dans un marché beaucoup plus vaste. Cela compte aussi quand il faut surmonter des barrières juridiques. Le service de musique européen Spotify, par exemple, a dû négocier son accès au marché dans chaque pays avec les organisations responsables. Étant donné qu’il n’est pas si facile de modifier la géographie, la Suisse ferait peut-être mieux de ne pas imiter la Silicon Valley, mais de se concentrer sur ses propres forces. Et celles-ci sont traditionnellement « petites, mais subtiles » plutôt que « grandes et encombrantes ».
Oui, je pense que les Suisses sont moins prêts à prendre des risques et moins avides de succès que les Américains, par exemple. Le point de référence est naturellement la Silicon Valley. À mon avis, c’est un problème général en Europe. Quelqu’un qui a étudié l’informatique en Suisse doit prendre une décision cruciale : soit il accepte un emploi intéressant et bien payé – non seulement tous les diplômés trouvent du travail, mais ceux qui ont du talent ont même le choix et peuvent gagner 8000 francs par mois –, soit il prend le risque de créer une « start-up », de travailler nuit et jour pendant trois ou quatre ans sans toucher un salaire décent et sans savoir de quoi l’avenir sera fait.
On dit qu’une sur dix réussit. C’est un risque extrême. En le prenant, on renonce à beaucoup de choses. Aux États-Unis, les incitations sont un peu plus avantageuses. Même avec des emplois confortables, les gens ont peu de vacances. Si l’on « tire le gros lot » avec une jeune pousse, on peut gagner plus d’argent et plus rapidement. En Suisse, peu de gens sont prêts à courir ce risque. À vrai dire, c’est un problème de riches. Peut-être que nous nous portons un peu trop bien. Cela expliquerait que nous n’ayons même pas besoin de prendre des risques.
Le résultat serait un juste milieu ennuyeux.
Le problème est qu’il n’y a pas d’innovation sans risque. On peut avoir mille bonnes idées, mais si personne ne se jette à l’eau pour les concrétiser, elles resteront des idées. Il existe des risques liés au marché, à la technologie du produit ou encore aux aspects légaux. En voulant les éliminer à tout prix, on étouffe aussi l’innovation.
La société Uber, intermédiaire en services de transport, court par exemple un risque par rapport au droit du travail, car un tribunal pourrait décider qu’il existe un rapport contractuel entre elle et les chauffeurs. Dès lors, son modèle d’affaires ne jouerait plus. En outre, les taxis sont souvent soumis à une très forte réglementation, ce qui est difficilement compatible avec le modèle d’Uber. YouTube est une autre entreprise qui n’aurait pas pu voir le jour sous le régime du droit d’auteur suisse, car nous n’avons pas de clause sur la sphère de sécurité (« safe harbor »). Dans ce contexte, il est extrêmement important de veiller à ce que les jeunes pousses suisses aient les mêmes chances que les autres. Ce serait nécessaire en particulier dans le secteur financier, si nous voulons attirer des « start-up » spécialisées dans les technologies financières. Mark Branson, le directeur de la Finma, l’a reconnu. Il recommande maintenant d’assouplir les lois. Les lettres de lecteurs sont un autre exemple. Alors que de jeunes pousses suisses, comme watson.ch, sont contraintes légalement de surveiller tous les commentaires postés par leurs utilisateurs, Facebook peut publier de tels messages instantanément et sans avoir pris connaissance de leur contenu. Plus les lois sont formulées de manière simple et générale, mieux elles sont adaptées aux défis du futur. À cet égard, la Suisse est, par bonheur, relativement forte.
Ce sont souvent des immigrants qui ont fondé les entreprises très performantes. Sergey Brin, cofondateur de Google, est né de parents russes et le père biologique de Steve Jobs est d’origine syrienne. En Suisse aussi, beaucoup de grandes firmes, comme Swatch ou Nestlé, ont été créées par des immigrants. Je pense que ce n’est pas par hasard. Un étranger est fortement incité à faire ses preuves. Souvent, les gens qui viennent de loin et qui acceptent des privations pour atteindre un objectif sont aussi très endurants.
On pourrait bien sûr essayer d’attirer de telles personnes en Suisse de manière ciblée. Parmi les candidats du monde entier qui se présentent chaque année, on choisirait par exemple les mille meilleurs et on les ferait étudier dans une université ou une haute école suisse. Évidemment, c’est délicat politiquement, car il s’agit de migration, mais cela augmenterait très vraisemblablement notre produit national brut. McKinsey parle d’une « guerre des talents » sur le point d’éclater. Les gens compétents sont aujourd’hui une ressource rare. Pour ce qui est du financement et de l’infrastructure, nous sommes bien dotés en Suisse.
Pendant sept ans, Wuala a rendu de grands services à des millions d’utilisateurs. De ce point de vue, c’était une réussite. Entre-temps, la majorité de nos concurrents de l’époque ont aussi mis la clé sous la porte. Je ne connais pas les raisons concrètes qui ont conduit Wuala à prendre cette décision, car je ne suis plus impliqué dans l’entreprise depuis début 2013. Cependant, Wuala est active dans un domaine qui perd progressivement de l’importance. Dropbox connaît le même problème. Les gens sont toujours moins souvent confrontés à des fichiers et à des dossiers. Par exemple, il n’y a plus d’explorateur de fichiers sur les téléphones portables. La situation est d’autant plus compliquée que de grandes entreprises de l’Internet, comme Google et Microsoft, offrent maintenant gratuitement des programmes analogues, souvent préinstallés.
L’avenir le dira. Nous ne le savons pas. Il s’agit bien sûr d’une spéculation sur une évolution future, laquelle peut se produire ou pas.
C’est surtout une obligation s’ils veulent s’assurer un avenir. La meilleure manière de le faire est naturellement de participer dès le début aux activités de ces jeunes pousses et de les soutenir. Ce procédé est donc raisonnable. Il ne garantit pas le succès, mais c’est une bonne stratégie.
Je le fais par intérêt personnel. Je ne crois pas que cela soit utile dans l’univers des jeunes pousses. L’économie est, à mes yeux, un thème extrêmement passionnant, parce qu’il s’agit en fin de compte de la manière dont le monde fonctionne. Je me suis inspiré de Hari Seldon, le personnage créé par Isaac Asimov dans le Cycle de Fondation. Je me trouvais dans la situation confortable où je pouvais me consacrer à quelque chose pendant deux ans par pur intérêt, sans me soucier de son utilité.
Proposition de citation: Nicole Tesar (2015). « L’État ne doit pas se mettre en travers du chemin ». La Vie économique, 26 octobre.
Luzius Meisser, 35 ans, a grandi à Klosters (GR) et a étudié l’informatique à l’EPFZ. En collaboration avec Dominik Grolimund, il a créé en 2007 le service de stockage Wuala. Deux ans plus tard, ces jeunes entrepreneurs ont revendu leur société à la firme française LaCie, qui sera à son tour rachetée par Seagate en 2012. C’est alors que Luzius Meisser a quitté Wuala. Tout en investissant dans le démarrage de jeunes pousses, il a enseigné l’informatique à la Haute école de la Suisse du Nord-Ouest (FHNW) à Brugg. En 2013, il a entamé des études d’économie à l’université de Zurich, qu’il devrait terminer en novembre prochain. Son travail de master s’intitule « Mastering Agent-Based Economics ». M. Meisser est également président de la Bitcoin Association Switzerland. Il vit avec sa famille dans le canton de Zurich.